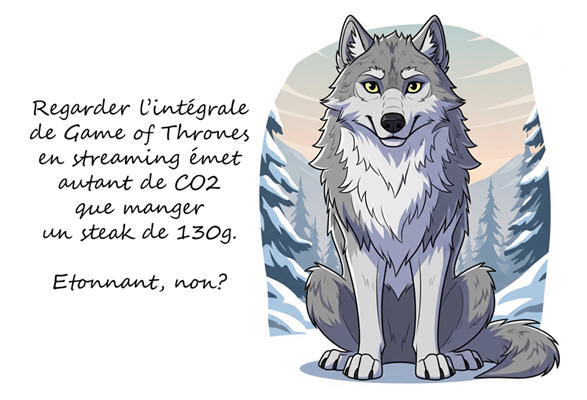Que sait-on mesurer ?
Lorsque nous avons commencé à nous intéresser à l’impact environnemental du streaming en 2019, l’époque était aux bilans carbone. Nous avons travaillé avec le Shift Project pour mettre en place une mesure des émissions équivalentes de CO2 liées au fonctionnement de la plateforme. Cette mesure était destinée à quantifier les émissions mais aussi à constater l’efficacité de stratégies de réduction.
Nos mesures reviennent à estimer la consommation électrique de tous les équipements pendant le temps de lecture d’une vidéo. La richesse des logs de diffusion nous permet de connaitre par exemple le volume exact de données transférées, le pays de consultation et le type de terminal utilisé. Grâce à des données comme le PUE des datacenters ou l’intensité carbone de l’électricité de chaque pays et à des constantes calculées à partir du « 1byte model », nous traduisons cette consommation électrique globale en volume d’équivalent CO2.
L’impact à la marge
Nous mesurons l’impact carbone d’un usage. Nous ne tenons pas compte de l’impact de la fabrication des équipements mis en œuvre dans la chaîne de diffusion, du datacenter au terminal, car nous ne disposons pas de données fiables. Nous utilisons donc une approche marginale.
Nous avons également fait abstraction des autres impacts que les gaz à effet de serre : eau, ressources abiotiques, terres rares, etc.
Notre mesure n’est pas standardisée et n’a pas vocation à l’être. C’est une mesure de référence pour comparer les impacts relatifs de différents usages et pour observer des variations.
Les ACV : quand le mieux est l’ennemi du bien
Depuis quelques années, les études d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) se généralisent. Elles intègrent tous les impacts de la fabrication des équipements. Avec la multiplication des paramètres pris en compte par rapport à un simple bilan carbone, la complexité du calcul grandit et le nombre d’approximations aussi, car on ne connait jamais vraiment les caractéristiques des équipements utilisés dans une solution « cloud ».
L’AVC fait apparaître un impact très supérieur de la fabrication des équipements par rapport à leur utilisation, avec une conséquence perverse : une fois qu’un équipement a été fabriqué, on considère que le mal est fait et que son usage n’aura plus de conséquences significatives. Pour l’ADEME ou GreenIT, promouvoir la sobriété numérique c’est inciter les consommateurs à faire durer leurs équipements, sans les inciter à en faire un usage modéré, car ne pas renouveler un équipement a plus d’impact que moins l’utiliser.
L’effet pervers de cette approche est d’encourager l’inaction (« tant que je ne renouvelle pas mon téléphone, je fais du bien à la planète ») sans réduire les usages ou leur impact.

En insistant sur les impacts relatifs de la fabrication et de l’utilisation et en mélangeant des effets immédiats et différés, on encourage une forme de procrastination climatique. Peut-on s’autoriser un bain par jour au motif qu’on a repoussé d’un an un voyage en avion, dont l’impact est bien supérieur ?
L’ACV conduit même à des absurdités, comme le fait de considérer que la pratique audiovisuelle qui a le plus fort impact environnemental est l’écoute de la FM en voiture, car il est tenu compte de l’impact de la fabrication et du fonctionnement du véhicule.
Pour ces raisons, nous restons attachés à l’approche marginale car elle mesure des impacts directs qu’il est possible de réduire. Des impacts relativement faibles, mais dont toute réduction produit un bénéfice immédiat et sans effet rebond.
Entre une petite réduction d’émissions de GES et le report d’un achat électronique d’un an, pourquoi choisir ?
Quelques ordres de grandeur
On considère qu’une heure de vidéo lue en streaming en France émet en moyenne 50 grammes de CO2. Est-ce beaucoup ou peu ?
Dans le monde professionnel, la première pratique numérique responsable qui vient à l’esprit est la suppression des mails. Un tiers des salariés la considère très efficace, mais il faut supprimer 10 000 mails pour économiser sur un an l’équivalent des 50 grammes de CO2 émis par une heure de streaming.
Le streaming a beaucoup, beaucoup plus d’impact que le nettoyage de sa boîte mail…
Une heure de streaming a le même impact carbone que 250 m parcourus avec un véhicule thermique, en 11 secondes. Elle a aussi le même impact que la consommation de 2 grammes de viande bovine. Autrement dit, il faut regarder 80 heures de streaming pour atteindre l’impact CO2 d’un steak de 150 grammes.
Notons au passage qu’une heure de streaming équivaut à 43 requêtes IA simples (sur Mistral AI) ou environ 4 générations d’images.
Le streaming (tout comme l’IA) a beaucoup, beaucoup moins d’impact que la consommation de viande…
Dans ce contexte, chercher à réduire l’impact de son streaming a-t-il un sens ?
Si on divise par cinq l’impact d’une heure de streaming, il passera de 250 m parcourus avec un véhicule thermique à 50 m. Cela vaut-il l’effort ? Non si c’est à l’internaute de le faire, oui si la plateforme le fait pour lui. C’est pourquoi il faut…
Inverser la charge
La loi REEN visant à Réduire l’Empreinte Environnementale du Numérique en France demande aux services de télévision et plateformes de streaming de diffuser des messages qui recommandent aux utilisateurs (internautes) d’adopter des comportements plus sobres, de choisir des réglages plus respectueux de l’environnement.
La vraie singularité de notre démarche est que nous ne demandons rien aux « utilisateurs » mais que nous permettons aux diffuseurs de de les rendre plus vertueux à leur insu.
Nous ne misons pas sur la conscience environnementale des internautes, qui renonceraient à regarder une vidéo sur leur téléviseur 4K pour la regarder sur leur smartphone en Wifi parce que l’impact est moindre. Nous n’attendons pas qu’ils baissent par eux-mêmes la résolution du flux qu’ils reçoivent tant qu’ils ne perçoivent pas de différence de qualité.
71 % des Français se déclarent prêts à faire des efforts pour réduire leur impact numérique, mais combien les font ? Dans un registre d’actions encore plus impactantes, 61 % des Français ne veulent pas se passer de voitures thermiques, 60 % ne veulent pas payer plus pour des aliments locaux et 68 % ne veulent pas arrêter de manger de la viande.
Dans le secteur professionnel, 74 % des Français sont conscients de l’impact écologique lié à leurs usages numériques, mais 51 % maintiennent des pratiques peu vertueuses par habitude ou pour gagner en efficacité.
Faut-il espérer que la fraction de la population la plus sensibilisée à l’écologie change ses habitudes ou faut-il réduire l’impact pour 100% de la population quand c’est possible ?
Un étude de SciencesPo réalisée en mai 2024 pour l’ADEME montrait une forte attente de la population française pour une action régulatrice de l’Etat et plus de sobriété / d’écoconception de la part des fabricants d’équipements et des fournisseurs de services numériques.
Lors de la pandémie de Covid, pour éviter une éventuelle congestion de son réseau, Netflix avait réduit ses débits moyens par défaut. Les internautes étaient libres de les augmenter s’ils en ressentaient le besoin. Netflix ne pariait pas sur leur altruisme ou leur conscience écologique pour baisser par eux-mêmes la qualité du flux qu’ils recevaient…
En cessant de transmettre le flux vidéo lorsqu’on détecte que la vidéo est simplement écoutée, on économise 97% du volume de données… et l’impact associé à ce transit. Le mode « audio seul » est une des recommandations du RGESN, que Streamlike est à ce jour la seule plateforme à proposer.
Le streaming, c’est comme le sucre. La meilleure manière d’en consommer moins n’est pas de se restreindre, c’est de demander (ou d’imposer) aux fabricants de réduire le taux de sucre dans leurs aliments.
Ecoconception : 2 poids 2 mesures ?
L’écoconception vise en particulier à réduire les émissions à la source, sans action des internautes.
Selon l’ADEME, « un site écoconçu est un site pensé pour être moins énergivore, plus respectueux de l’environnement et qui adopte une posture éthique sociétale ». Pour cela, le principal levier mis en avant est de réduire le poids des pages car « plus la page est lourde, plus le coût énergétique pour les calculs serveurs et l’usage du réseau sont élevés ».
Dans un site, ce qui « pèse », ce sont les requêtes pour charger des contenus tiers, les images et les vidéos. Une image, c’est entre 50 et 300 Ko de données. Une vidéo YouTube dans une page, c’est une vingtaine de requêtes pour environ 3 Mo de données reçues et 1 Mo de données envoyées, sans même avoir démarré la vidéo. Une minute de vidéo lue en HD, c’est plus de 40 Mo de données transférées.
L’écoconception, c’est le domaine du Référentiel Général d’Ecoconception des Services Numériques (RGESN), qui propose des recommandations. Comme ce sont les vidéos intégrées aux sites qui ont -de très loin- le plus gros impact, le RGESN recommande de ne pas en mettre.
Pour la quasi-totalité des sites que se revendiquent éco-conçus et en conformité maximale avec le RGESN, la recommandation est interprétée en « cachez vos vidéos hors de votre site ». Dans le pied de page, vous trouverez généralement le lien vers une chaîne YouTube ou Dailymotion. Les vidéos sont-elles destinées à être monétisées, à faire le buzz ou a susciter des réactions? Pas toujours… il s’agit généralement d’une « optimisation environnementale » consistant à utiliser un réseau social en lieu et place d’un hébergement professionnel qui aurait été plus écoresponsable, mais probablement payant.

L’impact environnemental d’une chaîne YouTube doit-il être affecté à YouTube ou au créateur des contenus?
Si l’on prend l’analogie d’un fabricant de textiles (au demeurant éthique et écoresponsable), est-ce que leur expédition par avion à travers le monde est à imputer à son bilan carbone ou à celui du transporteur aérien?
Si l’on considère que l’impact des chaînes YouTube est imputable aux créateurs des contenus, il devrait en être tenu compte dans l’évaluation de l’écoconception des sites qui les référencent, parce qu’il existe des moyens plus écoresponsables d’héberger des vidéos qu’en les postant sur un réseau social.
Rappelez-vous l’impact dérisoire mais symboliquement élevé de la suppression des mails et considérez que les vidéos déposées sur un réseau social ne sont jamais supprimées… Nous avons là un impact considérable mais totalement ignoré. Les comptes YouTube débordent de vidéos obsolètes que plus personne ne regarde mais qui sont conservées en haute disponibilité, dans des qualités multiples sur plusieurs data centers, au prix d’une consommation électrique passive considérable.
Alors, si un site écoconçu doit « être moins énergivore et adopter une posture éthique sociétale », il serait pertinent de tenir compte des vidéos qui ont été sorties des sites, parce que leur impact est bien plus important que celui des sites eux-mêmes.
Si vous êtes vous prêt.e à assumer l’impact -limité- de vos vidéos et à les diffuser sobrement pour « faire votre part », notre formule streamlike.eco démarre à 30 €HT/ mois et suffit pour remplacer 95% des chaînes YouTube d’entreprises, d’administrations ou d’associations. Au passage, vous alignerez vos actes avec vos valeurs.
Un peu de lecture en plus
Rappelons en complément ce que nous avons déjà écrit sur le sujet.
- Une étude pour prendre du recul
- Streaming et commande publique
- Le RGESN nouveau est arrivé
- Loi REEN : les premières recommandations visent les consommateurs
- Si la vidéo n’est pas visible, diffusez l’audio seul
- Comment gagner facilement 18 points sur le référentiel RGESN?
- La vidéo, grande oubliée de l’éco-conception ?
- YouTube est-il écoconçu ?
- Bonnes pratiques pour un streaming responsable
- Mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au streaming
Pour d’autres sources et une mise en perspective encore plus complète, nous vous invitons à aller regarder la vidéo du Réveilleur… sur YouTube !